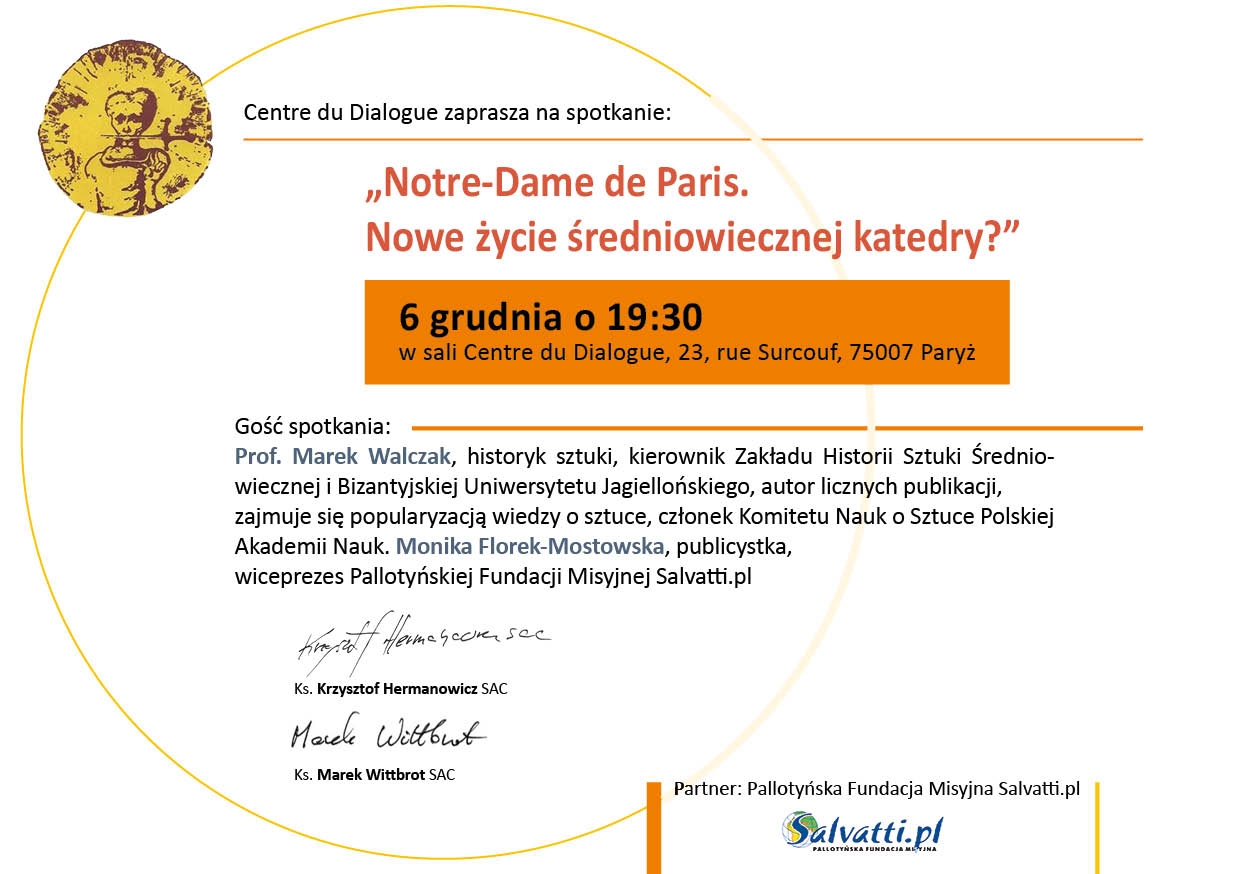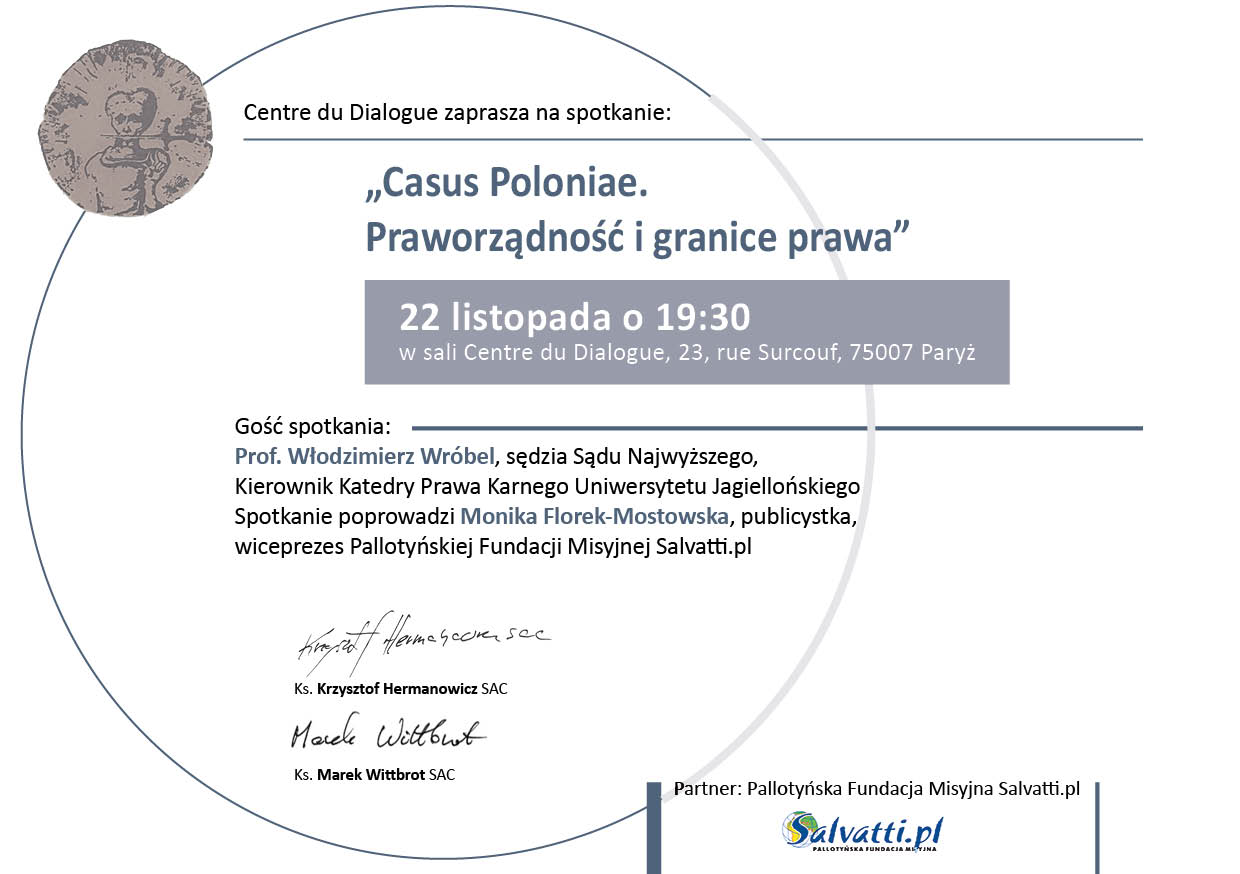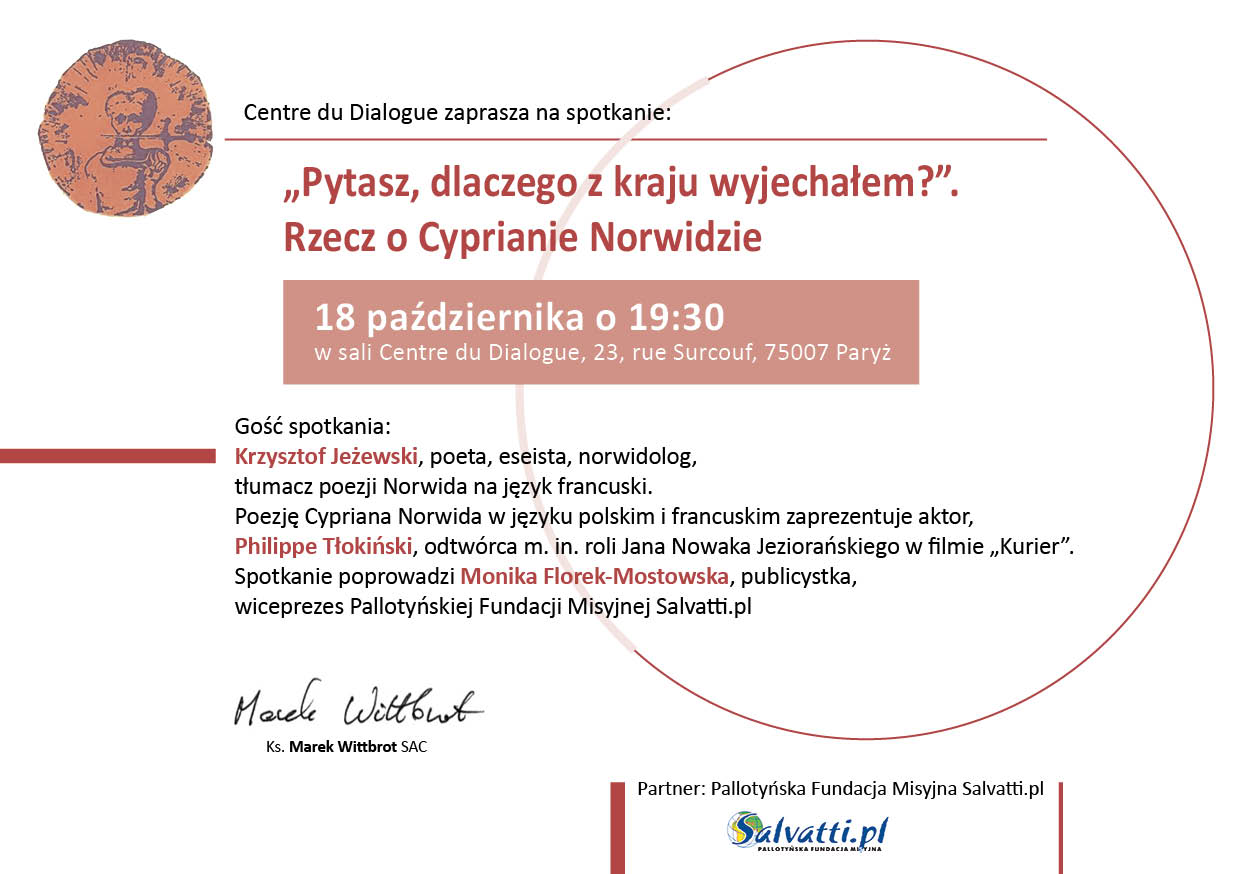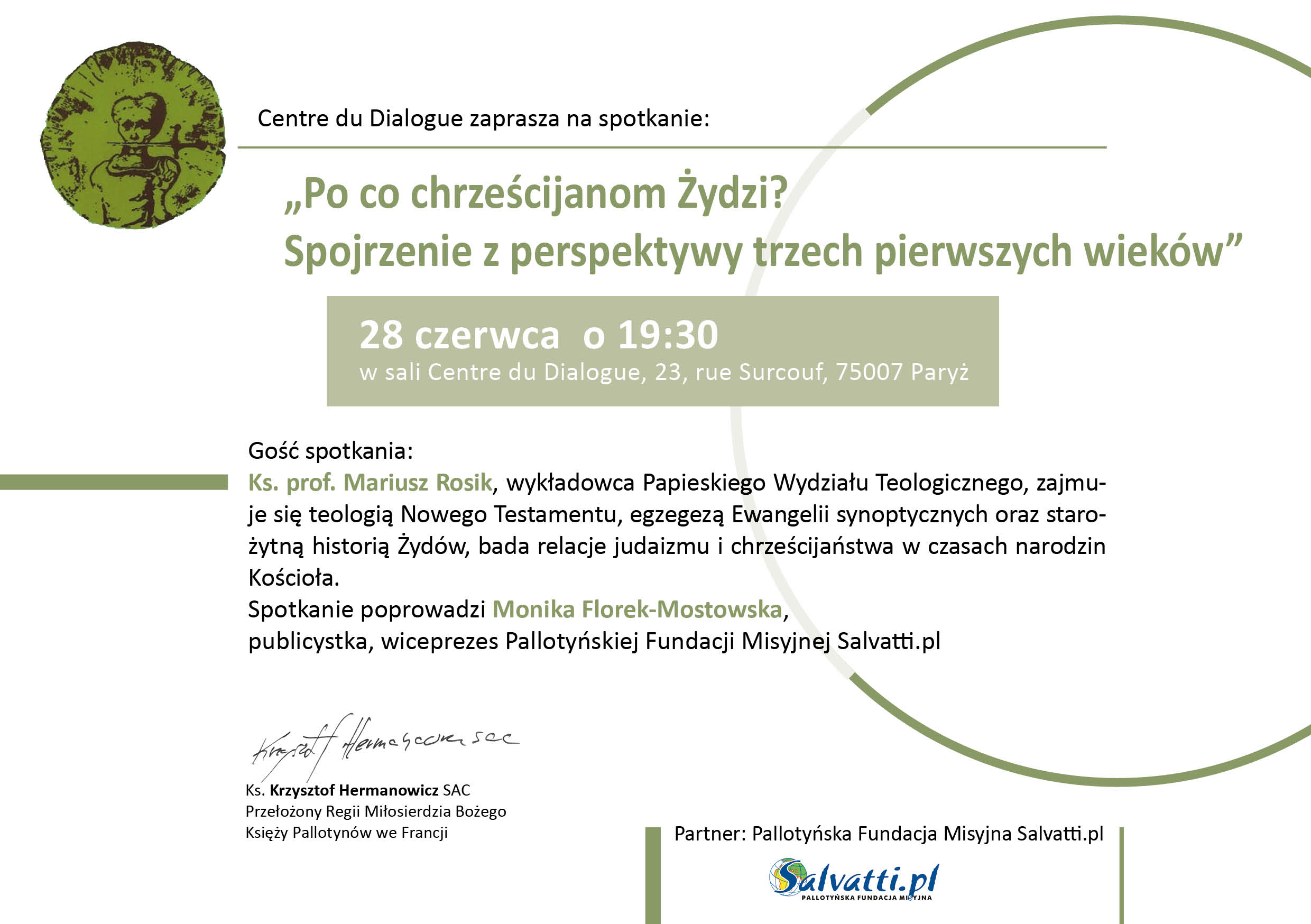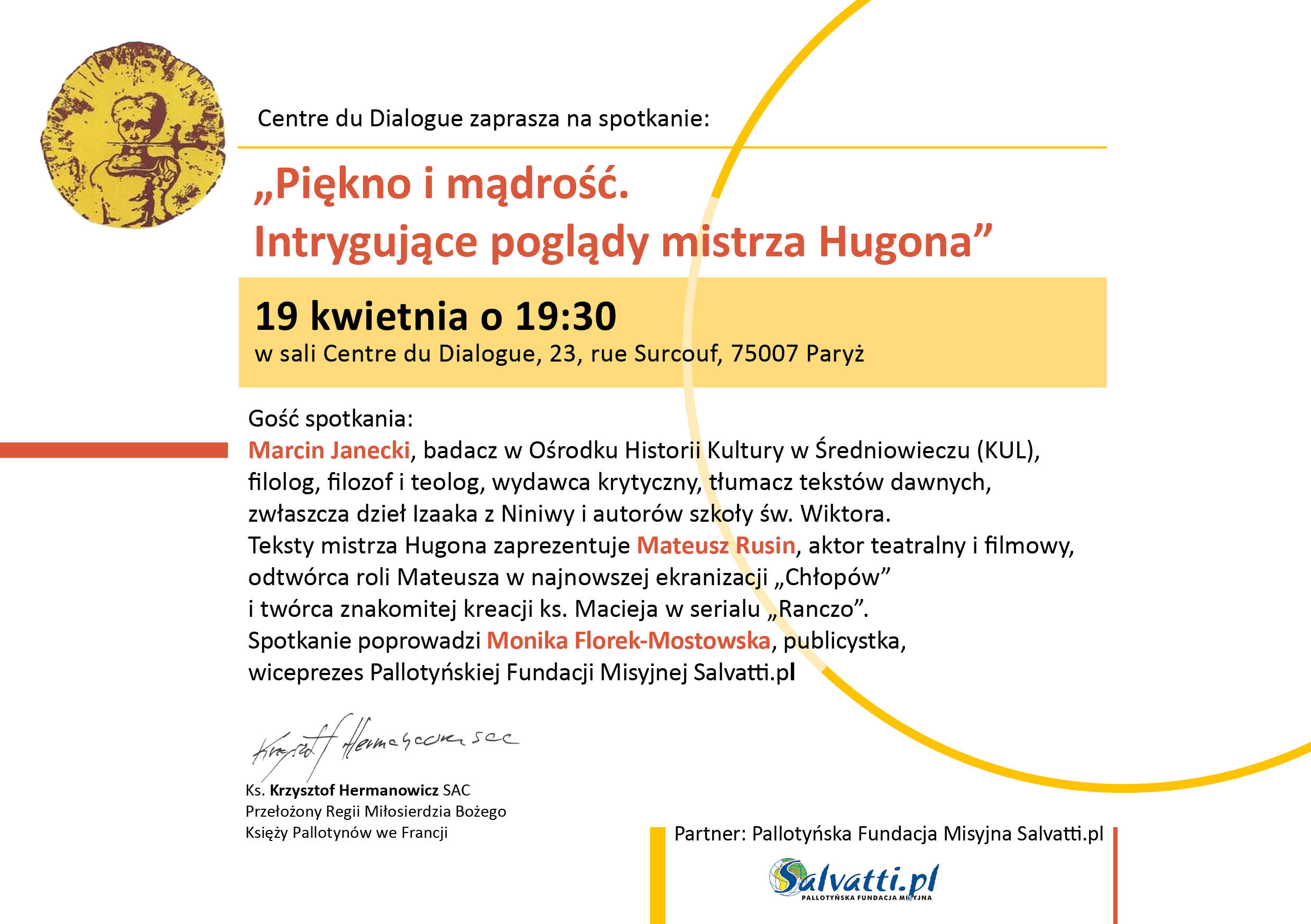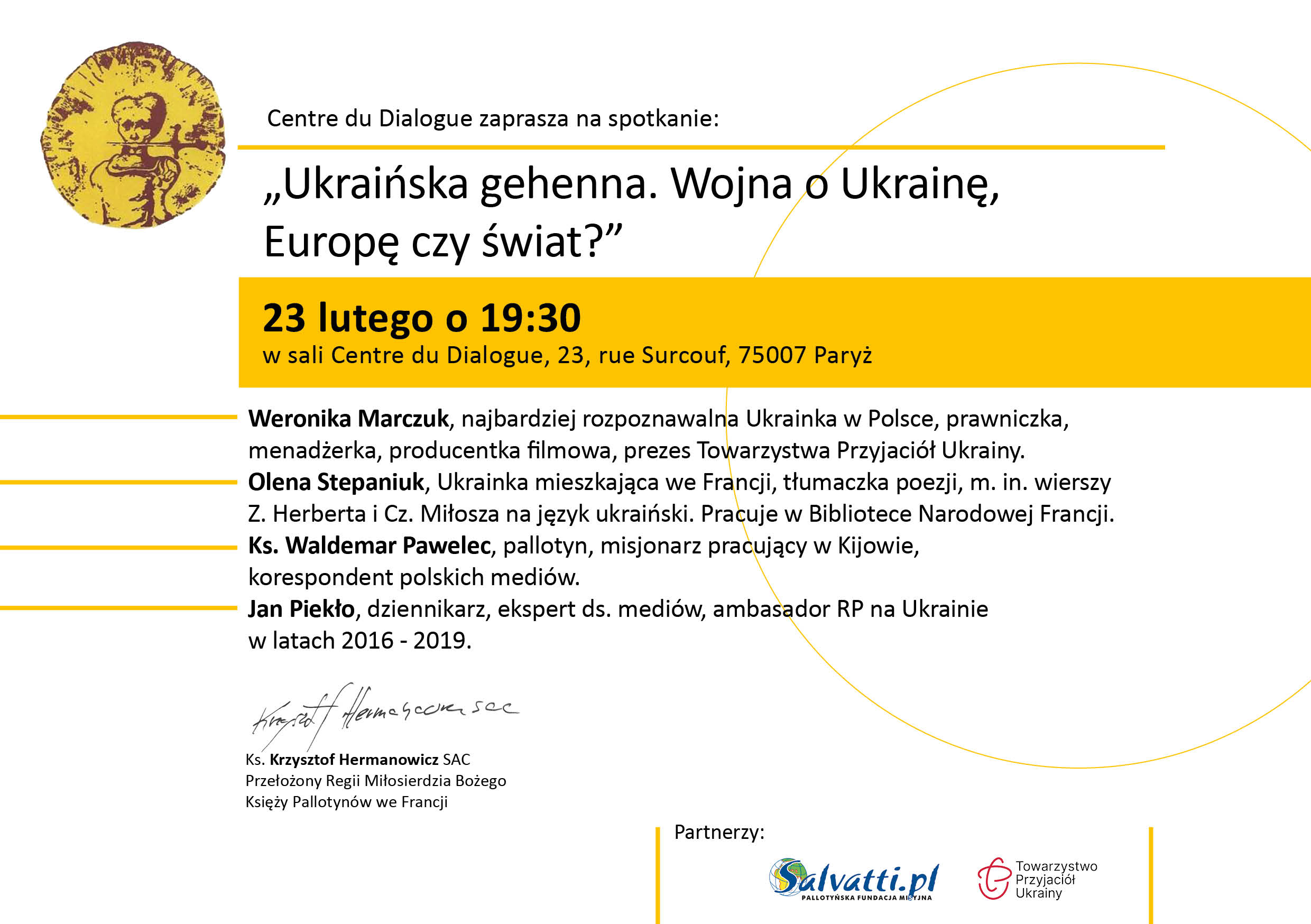Centre du Dialogue / spotkania w 2024 r.
6 grudnia 2024 / Prof. Marek Walczak

Pięć lat po pożarze katedra Notre-Dame zostaje na nowo otwarta. Z tej okazji w pallotyńskim Centre du Dialogue odbyło się spotkanie pt. „Notre-Dame de Paris. Nowe życie średniowiecznej katedry?” Prof. Marek Walczak oraz Monika Florek-Mostowska, Centre du Dialogue 6 grudnia 2024. Fot. A.M.
22 listopada 2024 / prof. Włodzimierz Wróbel
Chrześcijanie w Polsce niewystarczająco angażują się w życie publiczne. Taki wniosek wypłynął ze spotkania pt. „Casus Poloniae. Praworządność i granice prawa” zorganizowanych w Centre du Dialogue w Paryżu we współpracy pallotynów z Francji oraz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Gościem spotkania był prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centre du Dialogue w Paryż, gośc spotkania prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Monika Florek-Mostowska. Fot. A.M.
18 października 2024 / Krzysztof Jeżewski
O twórczości Cypriana Norwida dyskutowali eksperci w pallotyńskim Centre du Dialogue w Paryżu podczas spotkania zatytułowanego: „Pytasz, dlaczego z kraju wyjechałem? Rzecz o Norwidzie”. Poezję Norwida w języku polskim i francuskim prezentował aktor Filip Tłokiński. Wieczór zorganizowany przy współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl, który poprowadziła Monika Florek – Mostowska, wiceprezes Fundacji, otworzył kolejny sezon cyklicznych spotkań w słynnym paryskim Centre du Dialogue, prowadzonym przez księży pallotynów.

Krzysztof Jeżewski, Philippe Tłokiński oraz Monika Florek-Mostowska na spotkaniu w Centre du Dialogue. Fot. Marek Wittbrot

Spotkanie w Centre du Dialogue. Fot. Marek Wittbrot
28 czerwca 2024 / ks.prof. Mariusz Rosik

ks.prof. Mariusz Rosik, oraz Monika Florek-Mostowska
na spotkaniu w Centre du Dialogue. Fot. Marek Wittbrot
DARIUSZ DŁUGOSZ - LA SÉPARATION DE LA SYNAGOGUE DE L’ÉGLISE, OU L’HISTOIRE DES JUDÉO-CHRÉTIENS DANS LES TROIS PREMIERS SIÈCLES
DARIUSZ DŁUGOSZ
Musée du Louvre
À travers les yeux d’un historien et bibliste…
LA SÉPARATION DE LA SYNAGOGUE DE L’ÉGLISE, OU L’HISTOIRE DES JUDÉO-CHRÉTIENS
DANS LES TROIS PREMIERS SIÈCLES
Au Centre de Dialogue de Paris, actuellement dirigé par le père Krzysztof Hermanowicz, Supérieur de
la Région de la Divine Miséricorde des pères pallottins en France, qui l’année dernière a célébré son demi-siècle d’activité, a eu lieu une rencontre le vendredi 28 juin 2024 avec un bibliste
polonais, le professeur Mariusz ROSIK intitulé «Pourquoi les chrétiens ont-ils besoin des juifs? Un regard du point de vue des trois premiers siècles». Les organisateurs et animateurs de la rencontre
étaient Monika Florek-Mostkowska, publiciste et vice-présidente de la Fondation Missionnaire
Pallottine Salvatti, et le père Marek Wittbrot, éditeur du portail pallottin Recogito.
Le père Mariusz Rosik (né en 1968 à Wrocław) est professeur de sciences théologiques et chargé de
cours à la Faculté pontificale de théo- logie de Wrocław. Il était boursier de centres de recherche renommés en Israël dans le domaine des études bibliques et de l’archéologie biblique, et notamment:
à l’Université Hébraïque et à l’École française archéolo- gique et bibliques de Jérusalem. Depuis
2006 il est directeur des études bibliques de troisième cycle et, entre 2007 et 2014, il a également été directeur de l’Institut d’études bibliques. Il dirige actuellement le dé- partement de théologie du Nouveau Testament à la Faculté pontificale de Wrocław. Le professeur Rosik est
l’auteur de plusieurs publications sur des études bibliques et évangéliques et de nombreux articles scien- tifiques et pastoraux, ainsi que rédacteur de publications collectives1.
1 Cf. Nowe odkrycia: fałszerstwa czy wyzwania dla wiary? (Wrocław 2006); Wprowadzenie do
literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. (Wrocław 2009; seria: Bibliotheca Biblica); Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu (2016).
La réunion de Paris était une tentative scientifique de répondre à ce qui préoccupe aujourd’hui l’Église: pourquoi les chrétiens ont-ils be- soin des Juifs? La présence religieuse active de nombreuses commu- nautés judéo-chrétiennes, également appelées en Terre Sainte les Juifs
messianiques, ne peut plus être ignorée par l’Église du XXIe siècle, tant au niveau du ministère pastoral, mais aussi au niveau théologique. Le Saint-Siège est donc en train de réviser ce qu’on
appelle la théo- logie de la substitution, qui affirme que le «peuple élu» de l’Ancien Testament, c’est-à-dire les Juifs, a été remplacé par la communauté ec- clésiale dans l’histoire du salut. Le professeur Rosik a répondu à de nombreuses questions d’ordre théologique et liturgique concernant la tendance judéo-chrétienne dans la perspective des trois premiers siècles, lorsque la séparation
historique et religieuse définitive de la Synagogue de l’Église, c’est-à-dire du judaïsme rabbinique du christianisme, re- ligion officielle de l’Empire romain, a eu lieu au début du IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin le Grand (306-337).
Il convient également de mentionner qu’à l’époque contemporaine le Concile Vatican II (1962-1965) a joué un rôle majeur dans la normali- sation moderne des relations entre le christianisme et le judaïsme, dont l’une des principales réformes a été l’initiation courageuse et active du dialogue
avec d’autres religions et confessions et c’est pourquoi le pape Paul VI a promulgué en octobre 1965 sa déclaration finale «Nostra ae- tate». Les chrétiens et juifs s’accordent sur le fait qu’au cours des deux mille ans de christianisme, il n’y a jamais eu de pape aussi intéressé à établir et à approfondir les liens avec le judaïsme que
Jean-Paul II, comme en témoigne le fait que le grand rabbin de Rome, Elio Toaff, qui recevant le pape polonais dans sa synagogue en 1986, a déclaré qu’avec la phrase décrivant les Juifs comme
«frères aînés dans la foi», Jean-Paul II a mis fin à deux mille ans de séparation historique entre le christianisme et le judaïsme. De même, le successeur de Jean-Paul II, le cardinal Josef Ratzinger, a rencontré à Vienne un groupe de juifs mes- sianiques, reconnaissant que les personnes
d’origine juive qui croient au Christ sont un instrument spécial de Dieu qui peut aider à combler la division historique entre Israël et le Communauté Ecclésiale.
En tant que pape émérite, Benoît XVI a commencé à réfléchir sur la nécessité de réviser, voire d’abandonner la théologie de la substitution, dans un essai publié dans Communio (2017), qui est son commentaire théologique et historique sur le traité De Iudeis (Sur les Juifs). En outre, la correspondance ultérieure du pape Benoît XVI avec Arie Folger, le grand rabbin de Vienne, a également été une source d’inspiration pour un nouveau
dialogue entre chrétiens et juifs messianiques. Son analyse de la Loi de l’Ancien Testament (en hébreu Torah) et, entre autres, le Psaume 51 sur le sacrifice dans la religion mosaïque et les
témoignages du Nouveau Testament (y compris «le Sermon sur la montagne», où Jésus déclare directement qu’il n’est pas venu pour abolir la Loi, mais pour l’accomplir, cf. Mt 5, 17-20), encourage clairement le Pape à dé- passer dans l’Église l’ancienne théologie de remplacement et à établir des relations vivantes entre le christianisme et le judaïsme messianique. Depuis, l’Église
a souligné la nécessité de revenir à ses sources juives… A la lumière de la rencontre à Paris avec le père Rosik soulève la question de l’histoire des communautés judéo-chrétiennes au cours des trois premiers siècles, car elles ont joué un rôle important dans le pro- cessus historique de
séparation de la Synagogue de l’Église. La question des tensions internes au sein des premières communautés chrétiennes de Terre Sainte au Ier siècle préoccupait paradoxalement les Juifs disciples du Christ, puisque lors de Concile de Jérusalem en 49 après J.-C., où la question de la nécessité d’un respect élémentaire des exigences de la Loi juive (Torah) par les chrétienspaïens convertis a été résolue 2. Dès lors, les chrétiens d’origine juive, ce que confirment également les écrits du Nouveau Testament, perdent progressivement leur identité juive, ou sont considérés comme des apostats, alors sont exclus de la synagogue, ou vivent dans des communautés judéo-chrétiennes (Nazaréens, Ebionites) qui n’ont pas survécu cependant en dispersion
qu’au IVe siècle. Alors, qu’est-ce qui a influencé la lente fin historique de ces com- munautés judéo-chrétiennes originelles et, par conséquent, la sépara- tion définitive de la Synagogue et de l’Église, c’est-à-dire du judaïsme rabbinique et du christianisme au 1er siècle? En tant qu’un historien et
bibliste, je voudrais souligner ici plusieurs raisons fondamentales, présentées pour plus de clarté dans l’ordre chronologique et historique:
– Les débuts du christianisme chez les Samaritains, enseignés par Jésus lui-même et plus tard par
Philippe (vers 37 après J.-C.).
2 Cf. Les Actes des Apôtres, 15,5-29, dans La Bible de Jérusalem, les éditions du Cerf, Paris 1998,
pp. 1898-1900.
– Les débuts du christianisme chez les juifs éthiopiens (baptême du courtisan de la reine vers 38
après J.-C.).
– Les origines et le développement de l’Église missionnaire, connus par les Actes des Apôtres, en
Palestine et en Méditerranée orientale, concernaient principalement la diaspora juive, et l’enseignement de l’Apôtre Paul se déroulait dans les synagogues locales (47-59 après J.-C.).
– Le décret de l’empereur Claude sur l’expulsion des Juifs de Rome (vers 49 après J.-C.), qui,
selon les écrits de Suétone, incluait à la fois les Juifs et les Judéo-chrétiens (problème de l’interprétation du mot Chrestos).
– L’incendie de Rome à l’époque de l’empereur Néron (environ 64 après J.-C.) et la persécution des
chrétiens et des judéo-chrétiens, avec une distinction claire entre les autres juifs et les adeptes du judaïsme.
– La première guerre juive contre Rome (66-70 après J.-C.), se terminant par la destruction du Temple de Jérusalem et les débuts de commu- nautés chrétiennes hors de Judée à Pella (aujourd’hui Jordanie).
– La taxation des Juifs par Rome (vers 73-74 après J.-C.), suite à l’échec du soulèvement juif et du Temple de Jérusalem, ce qu’on appelle Fiscus Iudaicus, lorsque l’ancien impôt du temple fut transformé en tribut au temple romain de Jupiter Capitolin (l’impôt ne s’appliquait pas aux communautés chrétiennes).
– La création de l’académie talmudique à Yavneh, près de l’actuelle Tel- Aviv (environ 90 après J.-C.), dont le fondateur fut Yochanan ben Zakkai, et les débuts du judaïsme rabbinique, qui remplaça l’ancien culte du Temple détruit à Jérusalem. La proclamation de l’excommu- nication des
juifs disciples du Christ de la synagogue sous la forme de la douzième bénédiction (en hébreu Birkat ha-minim) de la prière traditionnelle juive Shemone esre (Dix-huit bénédictions). Le début de l’histoire de la séparation officielle de la Synagogue de l’Église à la fin du premier siècle.
À son tour, l’analyse de l’histoire de la Judée romaine au IIe siècle nous permet de mentionner les faits historiques internes suivants au sein du judaïsme et du christianisme de cette époque qui ont
influencé le sort des communautés juives messianiques et la séparation plus profonde de la Synagogue de l’Église :
– La deuxième guerre juive contre Rome (132 – 135 après J.-C.), menée par Simon bar Kochba pour la
défense de Jérusalem et du judaïsme en raison d’une interdiction de la circoncision par l’empereur Hadrien, réprimée dans le sang et terminée par des répressions (notamment la construction du temple de
Jupiter Capitolin à Jérusalem sur le site de l’ancien Temple et de la colonie romaine d’Aelia Capitolina et l’in- terdiction des pratiques religieuses juives telles que la circoncision, le Shabbat et la cuisine casher, et enfin l’interdiction aux Juifs d’entrer dans la ville sous peine de mort). Les Juifs n’étaient autorisés à regar- der Jérusalem que de loin, et ils ne pouvaient
entrer dans l’enceinte du Temple que le 9e jour du mois Av pour pleurer la chute du Temple de Dieu au Mur Occidental en 70 après J.-C.
– En fin de compte, le nom de la province romaine fut également changé de Judée à Syrie Palestine
(Syrie palestinienne, ou Philistine – des anciens ennemis des Juifs, les Philistins).
– L’émergence des sectes judéo-chrétiennes au début du IIe siècle, telles que les Ébionites et les
Nazaréens, qui, en tant que disciples du Christ, maintenaient les lois et coutumes religieuses juives tradition- nelles, s’éloignant progressivement de l’Église ou étaient considérés et exclus comme hérésie.
– Les débuts de la tradition juive talmudique sur Jésus de Nazareth à la fin du IIe siècle (Mishna), dont les récits n’ont pas beaucoup de va- leur historique, mais témoignent de l’attitude polémique, négative ou hostile de la communauté rabbinique vers la figure de Jésus ou de la
communauté chrétienne. L’analyse ci-dessus de la situation historique et religieuse permet de mieux comprendre les raisons de la séparation définitive de la Syna- gogue de l’Église à la fin du Ier siècle et de la lente dispersion et dis- parition des communautés judéo-chrétiennes dans la région de la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient. Il est impossible de ne pas remarquer que la séparation croissante
des Juifs des communautés judéo-chrétiennes est directement liée à la situation du judaïsme à cette époque après la chute du Temple de Jérusalem (70 après J.-C.), lorsque le culte sacrificiel a cessé et que le lieu le plus saint des Juifs, qui ont également perdu leur patrie, a été détruit,
et les diverses interdictions de pratiques religieuses, telles que la circoncision, le Shabbat et les règles de la cuisine casher, ont menacé de perdre complètement non seulement l’existence de l’État, mais, ce qui est important pour les Juifs, leur iden- tité religieuse monothéiste et donc unique dans le monde du paganisme gréco-romain et oriental. Cette situation provoque un fort sentiment de menace pour l’existence nationale et une augmentation
des attitudes nationalistes, culturelles et
218 The Polish Journal of Biblical Research 23, 2024
religieuses. Le sauvetage fut apporté par la création, après la destruction du Temple de Jérusalem, d’un nouveau centre de vie juive, religieuse et politique, qui fut sans doute l’Académie talmudique de Yavneh, fon- dée par des rabbins (savants de la Loi) sous la direction de Yochanan ben Zakkai.
Son travail sur le texte de la Bible hébraïque et son canon s’est également déroulé vers 90 de notre ère. Au niveau communautaire ont été excommuniés de la synagogue les juifs qui reconnaissaient le Christ comme Messie, traités comme des hérétiques religieux (en hé- breuha-minim), et au niveau politique comme des traîtres, sapant l’es- sence du judaïsme, alors dominé par les rabbins. Ce contexte historique nous a permis mieux comprendre le drame des Juifs aux
Ier-IIe siècles, qui ont perdu leur propre patrie et en conséquence ils ont également ex- clu les juifs disciples du Christ et judéo-chrétiens de leur communauté religieuse et nationale afin de maintenir la pureté de «l’identité» juive. Nous le savons que cette drame s’est terminée avec la séparation histo- rique de la Synagogue de l’Église à la fin du premier siècle. Pour conclure, il convient de réfléchir aux analogies dans l’histoire polonaise de l’époque de
l’effondrement de la Pologne (des partitions du Royaume de Pologne au XVIIIe siècle jusqu’à l’occupation alle- mande et soviétique durant la deuxième guerre mondiale et à l’époque du régime
communiste…) où la menace existentielle a pesé sur elle. L’identité nationale et religieuse polonaise en danger et en péril a déter- minée des comportements radicaux («tout Polonais est catholique» ou encore «Celui qui n’est pas avec nous est contre nous»). Il s’avère alors que, paradoxalement, dans l’histoire des Juifs et des Polonais, ainsi que des juifs et des chrétiens, nous trouverons de nombreux traits communs aux communautés nationales et religieuses. C’est
peut-être une bonne chose que l’Église catholique revienne, après des siècles, à ses racines judéo-chrétiennes communes!
17 maja 2024 / Michał Żakowski

„Na dachu świata”. Izrael i Bliski Wschód. Co nas czeka?” – Spotkanie w Centre du Dialogue. Fot. A.M.
19 kwietnia 2024 / Marcin Janecki

Sylwetkę wybitnego myśliciela wieków średnich przybliżył Marcin Janecki, związany z Ośrodkiem Historii Kultury w Średniowieczu KUL, tłumacz tekstów dawnych, filolog, teolog i filozof podczas spotkania pt. „Piękno i mądrość. Intrygujące poglądy mistrza Hugona” zorganizowanym przez paryskie Centrum Dialogu i Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl. Teksty Hugona zaprezentował Mateusz Rusin, aktor znany m. in. z roli ks. Macieja w serialu „Ranczo”. Spotkanie poprowadziła Monika Florek-Mostowska, wiceprezes Fundacji Salvatti.pl. Fot. A. M.
15 marca 2024 / s. prof. Barbara Chyrowicz
Nie każdy człowiek jest uznawany za osobę. Według niektórych systemów filozoficznych, o byciu osobą decyduje sprawność umysłu. Jeśli tak to rozgraniczymy, możemy uznać, że część przedstawicieli gatunku Homo sapiens nie jest osobami. To daje asumpt do aborcji czy eutanazji. Przeciwko takim poglądom argumentowała s. prof. Barbara Chyrowicz, bioetyk na spotkaniu w Centre du Dialogue.

prof. Barbara Chyrowicz, bioetyk oraz Monika Florek-Mostowska
na spotkaniu w Centre du Dialogue. Fot. A.M.
23 lutego 2024 / Ks. Waldemar Pawelec, Olena Stepaniuk, Weronika Marczuk i Jan Piekło

Monika Florek-Mostowska oraz zaproszeni goscie: Ks. Waldemar Pawelec, Olena Stepaniuk, Weronika Marczuk i Jan Piekło na spotkaniu w Centre du Dialogue 24 lutego 2024. Fot. A.M.